2025
Suiveuses de guerre. De l’Ancien Régime à la Révolution
Marion Trévisi
Qui pourrait imaginer aujourd’hui que les femmes faisaient pleinement partie de la communauté militaire en France à l’époque moderne ? Pourtant loin d’être marginalisées, ces auxiliaires de service occupaient des rôles « support » auprès des soldats, ne cessant de s’adapter aux normes de genre et au quotidien harassant des hommes sur qui elles veillaient.
L’autrice redonne vie à ces femmes oubliées de l’histoire, les suiveuses ou compagnes des armées, qu’elle a traquées dans des archives de guerre et des mémoires de soldats et d’officiers de la fin du XVIIIe siècle, des armées révolutionnaires et du Premier Empire. Cet ouvrage réattribue leur juste place à ces épouses, mères de soldats, prostituées, cantinières et blanchisseuses qui participèrent à la communauté de campagne avec les hommes. Il conte leurs expériences, souvent minorées ou invisibilisées dans les récits officiels. Une autre vision des pratiques de la guerre « au ras du sol », du côté féminin, qui élargit le champ de l’histoire militaire.
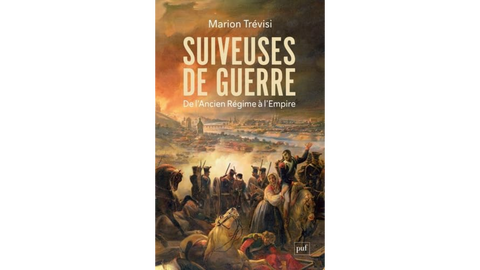
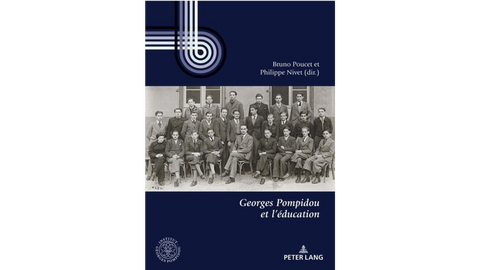
Georges Pompidou et l’éducation
Bruno Poucet et Philippe Nivet (dir.)
Normalien de la rue d’Ulm et agrégé de lettres, Georges Pompidou est, à ce jour, le seul président de la Ve République à avoir exercé le métier de professeur. Après avoir étudié quel professeur il a été et comment il ressentait l’exercice du métier, ce livre est consacré à la politique éducative qu’il a menée lorsqu’il a été Premier ministre et surtout quand il a exercé les fonctions de président de la République, après les événements de mai 1968 qui ont eu un fort impact sur la jeunesse et le monde éducatif. Après des contributions sur l’enseignement secondaire, l’enseignement supérieur, l’enseignement professionnel et technique et l’enseignement, privé des articles plus ciblés sont consacrés aux constructions scolaires dans les années Pompidou et à la manière dont les réformes ont été acceptées par le corps enseignant, les syndicats et les associations professionnelles. De nombreux documents, notamment la transcription d’un entretien avec son conseiller Jean-François Saglio, accompagnent ces contributions.
Les lieux de conflit et leur mémoire en Europe, de l'Antiquité au XXe siècle
Charles Giry Deloison et Philippe Nivet (dir.)
Avec les contributions de David Bellamy, Xavier Boniface, Olivia Carpi et Emmanuelle Cronier.
L’ouvrage aborde ces questions sur le temps long, celui qui court de l’Antiquité au XXe siècle et dans l’un des espaces les plus marqués par les conflits, le continent européen. Le conflit y est considéré comme un affrontement militaire (guerres interétatiques comme civiles), social ou politique accompagné d’actes de violence.
En sollicitant tous les vecteurs de la mémoire, l’ouvrage interroge la chronologie de la mémoire du lieu de conflit, son lieu de célébration (in situ ou déplacé), l’exactitude de sa représentation et son éventuelle utilisation politique. Il permet ainsi d’appréhender les évolutions tout comme les permanences de la mémoire du lieu de conflit depuis la Grèce antique et met en perspective celle de nos conflits du XXIe siècle.
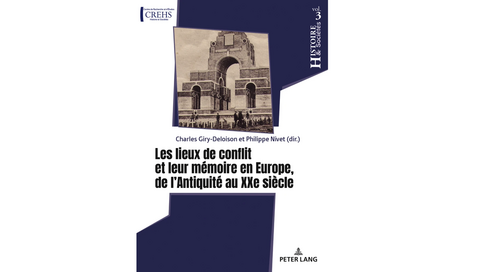
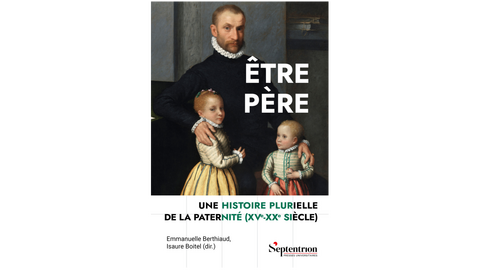
Être père. Une histoire plurielle de la paternité (XVe-XXe siècle)
Emmanuelle Berthiaud, Isaure Boitel (dir.)
Qu'est-ce qu’être père ? Comment la paternité était-elle pensée et vécue au cours des derniers siècles ? Le présent ouvrage cherche à éclairer les profondes mutations de la figure paternelle en Occident du XVe au XXe siècle. S’intéressant aux relations personnelles et concrètes des pères avec leurs enfants, notamment tout-petits, aux émotions de même qu’aux enjeux de transmissions et de pouvoir, les contributeurs de ce volume donnent à voir les expériences paternelles et les modèles qui s’imposent aux pères dans toute leur diversité. Au profit d’un dépassement de stéréotypes et de simplifications communes, historiens et historiens de l’art mènent ici une série d’études variées qui révèlent des pans méconnus de la paternité d’hier et d’aujourd’hui.
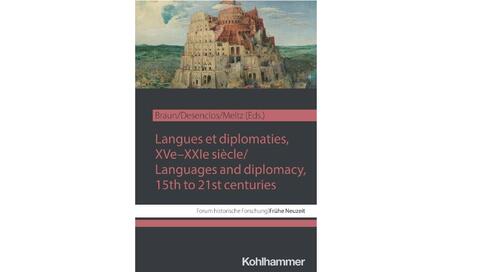
2024
Langues et diplomaties, XVe-XXIe siècle / Languages and diplomacy, 15th to 21st centuries
Les pratiques communicatives dans la diplomatie ont récemment suscité un intérêt accru dans la recherche. Malgré la prépondérance croissante d'une langue, les relations internationales, de la fin du Moyen Âge à nos jours, sont caractérisées par le multilinguisme. Comme cela entraîne souvent des problèmes de traduction, les traductions et les traducteurs jouent un rôle important de passerelle. Le présent ouvrage jette un regard transpériode et interdisciplinaire sur ces processus, du point de vue de la recherche historique, de la linguistique et de la traductologie. Une attention particulière est accordée aux acteurs et aux pratiques de la traduction, depuis le Royaume de Naples à la fin du Moyen Âge jusqu'à la Révolution française et aux Nations unies d'aujourd'hui.
"Partir ou rester". Journal de François Mathey, industriel vosgien en première ligne. 1914-1920
François Mathey (1859-1938) dirige le tissage de La Poterosse, à Senones, dans les Vosges. Le 12 septembre 1914, l'usine forme la ligne de front française dans ce secteur de la guerre de montagne. En 1918, après 4 années au cours desquelles il rédige un journal de guerre, il ne peut que constater la disparition de son usine comme de tout l'isolat industriel de La Poterosse, "mort pour la France".
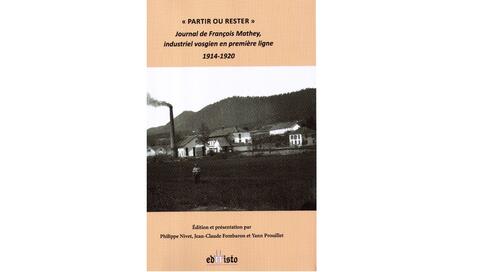
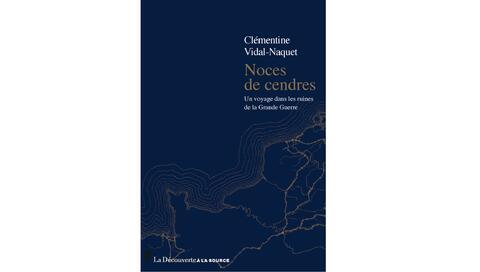
Noces de cendres. Un voyage dans les ruines de la Grande Guerre
Clémentine Vidal-Naquet
Une épaisse couverture de cuir, des pages cartonnées sur lesquelles sont disposées des photographies jaunies, parfois à moitié effacées, et des cartes postales touristiques, toutes soigneusement légendées. Au centre de la première page, un couple aux contours méticuleusement découpés : la femme en tenue de mariée, l’homme en uniforme. « Notre voyage de noces », lit-on au-dessus de leurs têtes ; « souvenir du 4 septembre 1919 » à leurs pieds. L’album, offert par un soldat tout juste démobilisé à sa femme pour leur premier anniversaire de mariage, montre villes et villages en ruines et en cendres, trous d’obus et paysages ravagés du nord de la France et de la Belgique.
Quelles aspirations, quelles espérances ont pu motiver un tel voyage ? En observant de façon intensive cet objet extraordinaire, en suivant pas à pas le périple insolite des jeunes époux dans les champs de bataille, Clémentine Vidal-Naquet révèle les traits marquants et parfois troublants d’une époque ; elle rend palpable l’inscription durable de la guerre dans les sphères conjugale et intime, après le silence des armes.
Enfants en guerre, guerre à l’enfance ? De 1914 à nos jours
Manon Pignot et Anne Tournieroux
L'actualité nous le rappelle : l'une des spécificités des conflits des XXe-XXIe siècles est de faire des civils des cibles à part entière. L'enjeu de ce livre est d'articuler le point de vue des enfants à celui des adultes, c'est-à-dire l'expérience enfantine de la guerre vis-à-vis des discours et injonctions émanant des adultes, des États en temps de conflits.
À la question « que fait la guerre aux enfants ? », la réponse paraît évidente : du mal. L'enjeu de ce livre et de l'exposition qu'il accompagne est d'accepter d'aller plus loin que l'évidence première, en dépassant le seul statut de victime. En d'autres termes, de complexifier l'analyse en réfléchissant aussi à ce que le temps de guerre peut représenter, pour certains enfants et adolescents, en termes d'opportunité, d'émancipation, de capacité d'action. En un mot : montrer que la guerre n'est pas traumatisante en soi, en soulignant la diversité des expériences enfantines, et en donnant du même coup leur juste place aux expériences traumatiques et paroxystiques.
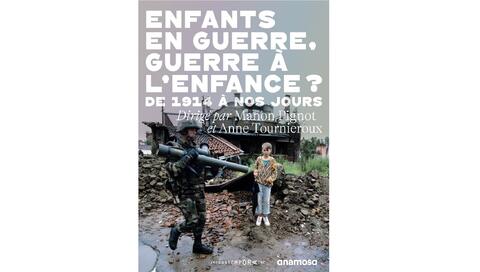
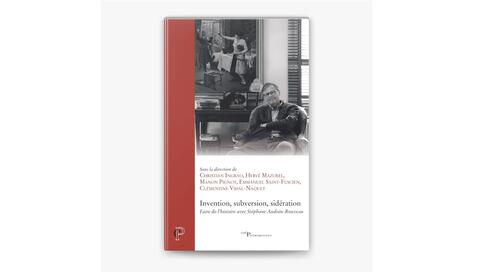
Invention, subversion, sidération. Faire de l'histoire avec Stéphane Audouin-Rouzeau
Christian Ingrao, Clémentine Vidal-Naquet, Emmanuel Saint-Fuscien, Hervé Mazurel, Manon Pignot
« Je hais les jeunes. » Quiconque a croisé Stéphane Audoin-Rouzeau l’a sûrement déjà entendu asséner cette sentence définitive. L’outrance de la formule révèle précisément l’antiphrase : c’est bien parce qu’il aime les jeunes que ses élèves ont choisi de lui offrir ces Mélanges.
Acteur majeur de la transformation de l’histoire militaro-politique en une anthropologie historique du fait guerrier, Stéphane Audoin-Rouzeau contribue, depuis presque quarante ans, à rendre intelligible la violence de guerre. Spectateur et penseur du retour de la guerre dans les horizons d’attente européens, il a inauguré une démarche singulière dont il a su transmettre les ressorts à ses étudiantes et étudiants.
On ne trouvera pas ici d’aréopage historien convoqué pour l’occasion ; pas de ban ni d’arrière-ban pour célébrer près de quarante années de carrière universitaire. En somme, il ne s’agit pas d’une commémoration mais d’une invitation à continuer, ensemble, à faire vivre le style d’histoire qui est le sien. En ne recourant qu’à des anciens élèves, toutes g(v)énérations confondues, ce livre rend hommage à l’enseignant autant qu’à l’historien. Les textes réunis dans cet ouvrage dressent un portrait kaléidoscopique d’un homme et d’une œuvre, d’un homme dans son œuvre.
Stéphane Audoin-Rouzeau est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales et président du Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre (Péronne).
